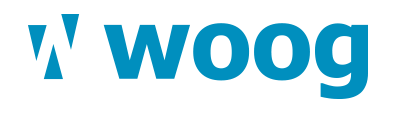Entreprises où salariés > 50
Qu’est-ce que c’est ?
Le Règlement intérieur (« RI ») permet à l’employeur de fixer unilatéralement l’ensemble des règles de conduite dans l’entreprise en matière de santé, sécurité et d’hygiène ainsi que la procédure disciplinaire, l’échelle et la nature des sanctions. Il est donc propre à chaque entreprise.
Il peut également comprendre des dispositions sur la prévention du harcèlement sexuel et moral.
À noter : les restrictions que le règlement impose aux salariés doivent être justifiées par la nature de l’activité à réaliser et proportionnées au but recherché.
Le règlement intérieur est-il obligatoire ?
La mise en place d’un règlement intérieur est obligatoire si l’effectif de salariés est supérieur ou égal à 50 pendant 12 mois consécutifs.
À noter : si l’employeur d’une entreprise comptant moins de 50 salariés choisit de rédiger un RI, il devra obligatoirement le transmettre au Conseil des prud’hommes si l’effectif est supérieur à 20 salariés.
Comment le règlement intérieur est-il mis en place ?
L’élaboration d’un règlement intérieur comporte plusieurs étapes :
- Rédaction par l’employeur
- Consultation des représentants du personnel(s’ils existent) : l’employeur doit obligatoirement consulter le comité social économique (CSE) pour qu’il donne son avis. S’il ne le consulte pas, le règlement ne pourra être opposable. L’avis n’est que consultatif.
À noter : l’employeur peut ne pas soumettre le RI au CSE si trois conditions cumulatives sont remplies (Cass. Soc., 30 septembre 2020, Société Petit bateau) :
– le but légitime ;
– la nécessité absolue ;
– la stricte proportionnalité au but recherché.
- Communication du règlement intérieur à l’inspecteur du travail : l’employeur communique en 2 exemplaires le règlement intérieur accompagné de l’avis du CSE à l’inspecteur du travail.
L’inspecteur du travail contrôle la légalité du règlement intérieur et conclut à sa conformité ou à sa non-conformité.
La décision de l’inspecteur doit être motivée et notifiée à l’employeur et aux membres du CSE dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Cette disposition s’applique également en cas de modification du règlement intérieur ou de retrait de clauses de celui-ci.
À tout moment, l’inspecteur du travail peut contrôler le règlement et exiger le retrait ou la modification des clauses qu’il juge contraires aux dispositions du code du travail.
- Dépôt et diffusion du règlement intérieur : simultanément à l’envoi du courrier à l’inspection du travail, l’employeur doit remplir 2 formalités complémentaires :
- le dépôt du RI au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement. Cette formalité, indispensable, est pourtant en pratique souvent oubliée par les entreprises.
- la diffusion du RI, par tout moyen (affichage, intranet…), aux personnes de l’entreprise dans les lieux de travail
Il devient opposable une fois cette dernière formalité accomplie.
Quand entre-t-il en vigueur ?
Le règlement intérieur indique la date d’entrée en vigueur. Cette dernière intervient au moins 1 mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et de diffusion.
Quelles sont les dispositions obligatoires ?
Le règlement intérieur doit impérativement contenir les clauses suivantes :
- Mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement (interdiction de fumer dans les locaux par exemple)
- Participation des salariés au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés (port d’un masque en cas d’épidémie par exemple)
- Règles concernant la discipline (respect des horaires de travail par exemple) et la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur (durée de la mise à pied disciplinaire par exemple)
- Dispositions concernant le respect des procédures disciplinaires (convocation à entretien préalable par exemple) pour le salarié si l’employeur envisage une sanction
- Dispositions concernant les droits de la défense des salariés (assistance du salarié lors d’une procédure disciplinaire par exemple)
- Dispositions concernant l’interdiction, la prévention et la répression du harcèlement moral et sexuel, les agissements sexistes
- Sa date d’entrée en vigueur
À noter : dans les entreprises de 500 salariés et plus et ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros, le règlement intérieur intègre un code de conduite. Ce document décrit les mesures à mettre en œuvre dans l’entreprise pour prévenir, en France ou à l’étranger, les faits de corruption ou de trafic d’influence.
Quelles sont les dispositions interdites ?
Le règlement intérieur ne peut pas contenir les clauses suivantes :
- Clause contraire aux lois, aux règlements, aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
- Clause restreignant les libertés individuelles ou collectives qui ne serait pas justifiée ou proportionnée au but recherché ;
- Clause de sanction discriminatoire ou financière.
À noter : La loi du 24 août 2021 autorise l’employeur à inclure dans les RI des dispositions interdisant le port de tout signe religieux distinctif à condition que les salariés concernés soient en contact avec le public. C’est ce qui est nommé la clause de neutralité.
Qui doit respecter le règlement intérieur ?
Le règlement intérieur s’impose à tous les salariés de l’entreprise, même les stagiaires, qu’ils soient embauchés avant ou après sa mise en application.
La Cour de cassation censure un arrêt de la cour d’appel de Paris qui n’avait pas ordonné la résiliation du bail.
Les juges d’appel auraient dû apprécier la gravité de la faute du locataire au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l’interdiction légale de sous-location et d’un changement de destination des locaux susceptible d’être caractérisé par l’utilisation répétée et lucrative d’une partie du logement conventionné.
Source : Cass. 3e civ., 22 juin 2022, FS-B
Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit en principe engager une recherche de reclassement, en un poste aussi comparable que possible à son ancien emploi et compatible avec les recommandations du médecin du travail.
L’employeur est dispensé de cette recherche si le médecin du travail a expressément indiqué que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Avant de présenter au salarié des propositions de reclassement, l’employeur doit consulter le CSE, en lui communiquant toutes les informations nécessaires sur l’état de santé du salarié (notamment les conclusions du médecin du travail) et la recherche de reclassement de façon à leur permettre de donner un avis en connaissance de cause. Cet avis n’est que consultatif.
La consultation a lieu :
- après le constat d’inaptitude du médecin du travail ;
- et avant la proposition de reclassement présentée au salarié inapte.
L’avis du CSE doit être recueilli que l’inaptitude soit d’origine professionnelle, c’est-à-dire consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou non professionnelle. Même si l’employeur n’a trouvé aucune solution de reclassement, il doit informer le CSE du résultat de ses recherches.
Il échappe toutefois à cette obligation dès lors qu’il n’y a pas de représentant du personnel dans l’entreprise (justifié le cas échéant par un PV de carence).
Mais peut-il aussi s’y soustraire lorsque, par exception, aucune recherche de reclassement ne s’impose ? Pour la première fois, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative :
l’inaptitude à tout emploi est une exception à la recherche de reclassement ET à la consultation du CSE.
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel.
Cass. Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500.
C’est quoi ?
Il s’agit pour le salarié d’une journée supplémentaire de travail par an, non rémunérée (Code du travail, art. L. 3133-7).
Les différentes modalités
La journée de solidarité peut être fixée :
- soit sur un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Par exemple, le lundi de Pentecôte ;
- soit sur un jour de repos accordé dans le cadre d’un aménagement du temps de travail ;
- soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (Code du travail, art. L. 3133-8).
La journée de solidarité peut être fixée un samedi ou prendre la forme de la suppression d’un jour de congé supplémentaire accordé par la convention collective, comme les jours d’ancienneté. En revanche, elle ne peut être fixée sur un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur.
Quel est le rôle des élus ?
L’employeur n’a pas l’obligation systématique de consulter les élus du CSE chaque année sur le sujet de la journée de solidarité.
2 hypothèses :
- l’organisation de la journée de solidarité relève en principe d’un accord d’entreprise, ou à défaut de la convention collective. Cet accord définit les modalités d’exécution de cette journée de solidarité. L’employeur suit chaque année les modalités prévues dans l’accord, sans avoir à consulter préalablement le CSE sur ce sujet.
! Cet accord ou cette convention peut cependant imposer une information annuelle des élus !
- en l’absence d’accord d’entreprise ou si la convention collective ne traite pas de la journée de solidarité, il appartient à l’employeur de définir de façon unilatérale les modalités d’organisation de la journée de solidarité. Il doit alors préalablement consulter les membres du CSE, chaque année, lequel rendra un avis consultatif, que l’employeur suivra ou pas.
Par un arrêt du 31 mars 2022*, Cour de cassation répond par la négative et rappelle le principe de subrogation légale de l’assureur posé à l’article L. 121-12 du code des assurances : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ». Elle ajoute que cet article « n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même ».
En l’espèce, la cour d’appel avait partiellement fait droit à la demande d’un assureur qui, sur ce fondement, avait agit contre l’assureur de l’auteur du dommage en paiement des sommes versées à l’assuré et à la société crédit-bailleresse du bien endommagé. L’arrêt d’appel est ainsi cassé par la Cour de cassation.
Alexandre James et Frédéric Lafond détaillent les éléments clés qu’il faut appréhender dans le dernier numéro du Journal du Management Juridique et Réglementaire.
Les dirigeants d’une société commettent une faute de gestion justifiant leur condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif à laquelle ils ont contribué, dès lors qu’ils prélèvent sur la trésorerie d’exploitation de cette dernière, via un compte courant d’associé débiteur non rémunéré, les montants nécessaires au remboursement de la dette bancaire d’acquisition contractée par la holding de rachat, dont ils sont également dirigeants et associés, alors même que les capacités financières de la société fille ne lui permettaient pas de distribuer des dividendes à la holding.
La loi 2021-1018 du 2 août 2021 vient renforcer la prévention en santé au travail et crée de nouvelles mesures concernant la prévention au travail, le suivi médical et la formation sécurité.
Elle transpose l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 2020 dans le but de créer « un système simplifié pour une prévention renforcée ».
Ce webinaire sera l’occasion de faire le point sur toutes les nouvelles dispositions qui viennent impacter l’entreprise dans son quotidien, comme par exemple la mise en place de nouvelles règles concernant le document d’évaluation des risques, l’instauration d’un passeport prévention pour les salariés, la formation des IRP, l’accès au dossier partagé des salariés, la visite médicale de mi-carrière, le recours à la télémédecine du travail, l’extension des missions des Services de Prévention et de Santé au Travail interentreprises et la fourniture de services obligatoires.
Maître Marie-Véronique LUMEAU du cabinet d’avocats WOOG vous exposera les principales orientations de la loi, fera le lien avec le contexte actuel et identifiera les conséquences des nouvelles dispositions pour les entreprises.
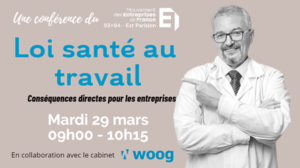
Le décret 2022-372 du 16 mars 2022 pris pour l’application de la loi santé au travail consacre deux changements majeurs :
| Visite médicale de reprise | Visite médicale de pré-reprise |
| Art. L 4624-2-3 C.trav. : maintien de l’examen de reprise pratiqué par le médecin du travail au terme d’un congé de maternité ou d’une absence pour maladie ou accident.
Art. R 4624-31 C.trav. al. 5 nouveau : pour les arrêts de travail résultant d’un accident ou d’une maladie non professionnelle et débutant après le 31 mars 2022, seule une absence d’au moins 60 jours impose l’organisation d’une visite médicale de reprise. |
Art. R 4624-29 C.trav. : possibilité de l’organiser au bénéfice des travailleurs absents depuis plus de 30 jours, au lieu de 3 mois auparavant. |